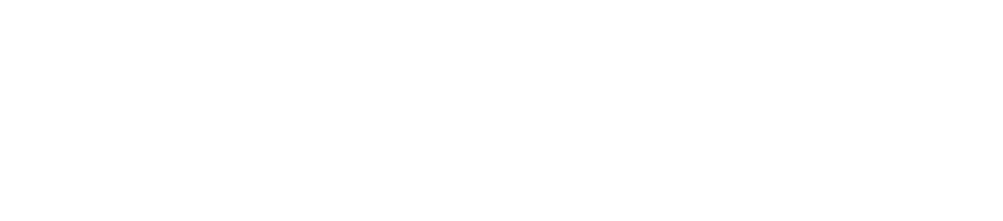Quand le jardin devient
thérapeutique
L’hortithérapie est une intervention non médicamenteuse* qui utilise le jardin, le jardinage et les relations avec la nature, pour prévenir, maintenir ou améliorer la santé physique, psychique et sociale des personnes accompagnées. Celles-ci s’engagent dans des activités de jardinage, conçues et encadrées par des professionnels formés, pour répondre à des intentions thérapeutiques spécifiques.
Elle se pratique au sein d’un jardin thérapeutique, espace d’animations et d’activités de jardinage adapté aux attentes et aux besoins de ses bénéficiaires. Il propose des ateliers sensoriels, de partage, de contemplation et de promenade.
* Reconnue par le Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS)
Différents types de jardins thérapeutiques
Le jardin thérapeutique s’adapte à chaque public et à chaque contexte. Il intègre trois principes structurants :

Pour marcher, déambuler, explorer, s’asseoir, contempler, discuter, écouter, sentir, toucher, picorer…
Le jardin où l'on est
Ce principe stimule la sensorialité (sentir une plante parfumée, toucher un feuillage duveteux, goûter une fleur, savourer un fruit rouge), développe la curiosité (découverte de plantes oubliées, inconnues ou de forme originale), invite à la contemplation et permet simplement d’être en relation avec la nature.

Pour semer, planter, arroser, récolter, tailler, rempoter, bouturer…
Le jardin où l'on fait
La pratique de l’hortithérapie est de faire et faire ensemble, tout en favorisant la pair-aidance. Ainsi, le jardin devient un lieu convivial, socialisant qui facilite la communication et l’entraide.

Pour imaginer un futur possible, rétablir la notion de temporalité, l’attente, la patience, la chronologie, le rythme des saisons…
Le jardin où l'on se projette
Les ateliers sont programmés sur une année. Des semis de fin d’hiver aux récoltes d’été et d’automne, le jardin est organisé selon les saisons et la possibilité ou non de travailler en extérieur.
Les végétaux à pousse lente sont favorisés. Ils participent à l’apprentissage de la patience, de l’observation, de l’importance de « prendre soin » dans la durée.
Des bienfaits multiples
Toucher la terre, y faire pousser fleurs et légumes, y être acteur… sont autant valorisants qu’apaisants. Par les stimulations sensorielles procurées, les visites régulières au jardin, la pratique du jardinage, l’entraide, etc., le jardin thérapeutique apporte de multiples bienfaits. Il est un médiateur du « prendre soin » qui procure du bien-être (selon la définition de l’OMS), favorise l’autonomie globale et impulse un désir de vie.
Sur le plan physique
- Il améliore la mobilité et la marche
- Il diminue les douleurs
- Il renforce la motricité fine et les praxies
Sur le plan psychique
- Il diminue le stress, l'anxiété et les angoisses
- Il restaure confiance et estime de soi
- Il apporte détente et plaisir
- Il ranime la curiosité et l'émerveillement
Sur le plan cognitif
- Il stimule la mémoire
- Il maintient les qualités de perception, d’attention, d’observation
- Il favorise la communication et le langage
Sur le plan social
- Il favorise les relations sociales
- Il renforce la perception des codes sociaux
- Il lutte contre l'isolement
- Il améliore la qualité de vie au sein de l’établissement
Un peu d'histoire
Les jardins thérapeutiques, une histoire qui s’écrit, se sème et essaime…
L’hortithérapie, contraction des mots horticulture (du latin horthus qui signifie « jardin ») et thérapie (du grec therápôn qui signifie « prendre soin »), est officiellement créée en 1973, en Californie, par un groupe de chercheurs et de thérapeutes, fondateurs de l’American Horticultural Therapy Association (AHTA). Formation et diplôme sont dispensés dans les universités de médecine. De nombreux programmes sont lancés. A partir des années 1980, l'intérêt grandit sur ce sujet, illustré par des publications scientifiques nombreuses, précises et reconnues.
Bien avant cette reconnaissance scientifique, les bienfaits de la nature et la pratique du jardinage sont reconnus.
- Les premiers textes soulignant le potentiel thérapeutique des jardins remontent à l’Antiquité. Ces écrits anciens relatent l’utilisation des jardins pour aider à soulager les accès de mélancolie ou de dépression. Un lien précoce est établi entre jardins et affects.
- Au XVIIIème, en Grande-Bretagne, des « refuges » sont créés dans des espaces verts et destinés aux malades mentaux.
- Aux États-Unis, Benjamin Rush, célèbre psychiatre, publie en 1812 un manuel sur le traitement des maladies mentales, dans lequel il souligne le rétablissement amélioré des patients dits « psychiatriques » lorsqu’ils travaillent au jardin. Sous son influence, une formation diplômante est enseignée à l’université à partir des années 1950.
- À la même époque, en France, on trouve maints témoignages similaires : à l’hôpital Bicêtre, dont les patients dits « aliénés » convalescents sont envoyés à la ferme de Saint Anne. À Lyon, où les jardins sont créés pour la rééducation des blessés de guerre...
François Tosquelles, médecin psychiatre de l’Hôpital de Saint Alban en Lozère, participe à la transformation révolutionnaire de la prise en charge des malades psychiatriques. Fondateur du courant de la « Psychothérapie institutionnelle », il réinterroge la relation du soignant au patient, humanisant le fonctionnement des établissements psychiatriques et prenant soin du collectif soignant.
Durant la Seconde Guerre mondiale, face au rationnement alimentaire et au manque de main d’œuvre, il ouvre les portes de l’hôpital psychiatrique. Les « aliénés » travaillent aux champs et sont rémunérés pour cela. Ils accèdent ainsi à la liberté de s’insérer à la vie locale.
L’hôpital de Saint Alban fut ainsi l’un des seuls, pendant la guerre, à ne dénombrer aucun patient décédé de faim.
Aujourd'hui, de très nombreux projets se lancent en France et dans le monde, dans la dynamique d’un mouvement déjà largement développé dans les pays anglo-saxons.
En Grande-Bretagne, les jardins thérapeutiques sont prescrits et remboursés par la Sécurité Sociale.
Créer des jardins adaptés dans les établissements médicalisés, des jardins partagés entre voisins de quartier, des jardins plantés en famille... sont des projets qui germent un peu partout.
La Fédération Française Jardins Nature et Santé, créée en 2018, dynamise un réseau d’acteurs œuvrant pour la pratique des jardins thérapeutiques. Elle préconise des définitions claires et prône une charte de bonnes pratiques. Malgré l’absence de diplôme d’Hortithérapeute en France, il existe plusieurs centres de formation reconnus. Un Diplôme Universitaire « Santé et Jardins » a été créé à Saint Étienne en 2022, à l’Université de médecine.
Le réseau associatif se développe en parallèle.
Les nombreux bienfaits des jardins thérapeutiques sont aujourd'hui largement documentés. Ci-après quelques références notables.
- Jérôme Pellissier, Jardins thérapeutiques et hortithérapie, Dunod, 2017.
- Sue Stuart-Smith, L’équilibre du jardinier, renouer avec la nature dans le monde moderne, Albin Michel, 2021.
- Anne Ribes, Toucher la terre, jardiner avec ceux qui souffrent, Médicis, 2005.
De nombreuses publications universitaires, sources et références scientifiques, sont répertoriées dans la bibliographie du site de la Fédération Française Jardins Nature et Santé.
Nous vous recommandons également le film documentaire de Cécile Favier « Binettes contre Anxiolytiques », produit par Un film à la patte.
Un peu d'histoire
Les jardins thérapeutiques, une histoire qui s’écrit, se sème et essaime…
La création officielle de l'hortithérapie dans les années 70
- L’hortithérapie, contraction des mots horticulture (du latin horthus qui signifie « jardin ») et thérapie (du grec therápôn qui signifie « prendre soin »), est officiellement créée en 1973, en Californie, par un groupe de chercheurs et de thérapeutes, fondateurs de l’American Horticultural Therapy Association (AHTA). Formation et diplôme sont dispensés dans les universités de médecine. De nombreux programmes sont lancés. A partir des années 1980, l'intérêt grandit sur ce sujet, illustré par des publications scientifiques nombreuses, précises et reconnues.
Les bienfaits des jardins reconnus depuis l'Antiquité
-
Bien avant cette reconnaissance scientifique, les bienfaits de la nature et la pratique du jardinage sont reconnus.
- Les premiers textes soulignant le potentiel thérapeutique des jardins remontent à l’Antiquité. Ces écrits anciens relatent l’utilisation des jardins pour aider à soulager les accès de mélancolie ou de dépression. Un lien précoce est établi entre jardins et affects.
- Au XVIIIème, en Grande-Bretagne, des « refuges » sont créés dans des espaces verts et destinés aux malades mentaux.
- Aux États-Unis, Benjamin Rush, célèbre psychiatre, publie en 1812 un manuel sur le traitement des maladies mentales, dans lequel il souligne le rétablissement amélioré des patients dits « psychiatriques » lorsqu’ils travaillent au jardin. Sous son influence, une formation diplômante est enseignée à l’université à partir des années 1950.
- À la même époque, en France, on trouve maints témoignages similaires : à l’hôpital Bicêtre, dont les patients dits « aliénés » convalescents sont envoyés à la ferme de Saint Anne. À Lyon, où les jardins sont créés pour la rééducation des blessés de guerre...
L'exemple célèbre de l'Hôpital Saint Alban durant la Seconde Guerre mondiale, en Lozère
-
François Tosquelles, médecin psychiatre de l’Hôpital de Saint Alban en Lozère, participe à la transformation révolutionnaire de la prise en charge des malades psychiatriques. Fondateur du courant de la « Psychothérapie institutionnelle », il réinterroge la relation du soignant au patient, humanisant le fonctionnement des établissements psychiatriques et prenant soin du collectif soignant.
Durant la Seconde Guerre mondiale, face au rationnement alimentaire et au manque de main d’œuvre, il ouvre les portes de l’hôpital psychiatrique. Les « aliénés » travaillent aux champs et sont rémunérés pour cela. Ils accèdent ainsi à la liberté de s’insérer à la vie locale.
L’hôpital de Saint Alban fut ainsi l’un des seuls, pendant la guerre, à ne dénombrer aucun patient décédé de faim.
Un mouvement aujourd'hui en plein essor en France
-
Aujourd'hui, de très nombreux projets se lancent en France et dans le monde, dans la dynamique d’un mouvement déjà largement développé dans les pays anglo-saxons.
En Grande-Bretagne, les jardins thérapeutiques sont prescrits et remboursés par la Sécurité Sociale.
Créer des jardins adaptés dans les établissements médicalisés, des jardins partagés entre voisins de quartier, des jardins plantés en famille... sont des projets qui germent un peu partout.
La Fédération Française Jardins Nature et Santé, créée en 2018, dynamise un réseau d’acteurs œuvrant pour la pratique des jardins thérapeutiques. Elle préconise des définitions claires et prône une charte de bonnes pratiques. Malgré l’absence de diplôme d’Hortithérapeute en France, il existe plusieurs centres de formation reconnus. Un Diplôme Universitaire « Santé et Jardins » a été créé à Saint Étienne en 2022, à l’Université de médecine.
Le réseau associatif se développe en parallèle.
La science en parle
-
Les nombreux bienfaits des jardins thérapeutiques sont aujourd'hui largement documentés. Ci-après quelques références notables.
- Jérôme Pellissier, Jardins thérapeutiques et hortithérapie, Dunod, 2017.
- Sue Stuart-Smith, L’équilibre du jardinier, renouer avec la nature dans le monde moderne, Albin Michel, 2021.
- Anne Ribes, Toucher la terre, jardiner avec ceux qui souffrent, Médicis, 2005.
De nombreuses publications universitaires, sources et références scientifiques, sont répertoriées dans la bibliographie du site de la Fédération Française Jardins Nature et Santé.
Nous vous recommandons également le film documentaire de Cécile Favier « Binettes contre Anxiolytiques », produit par Un film à la patte.